
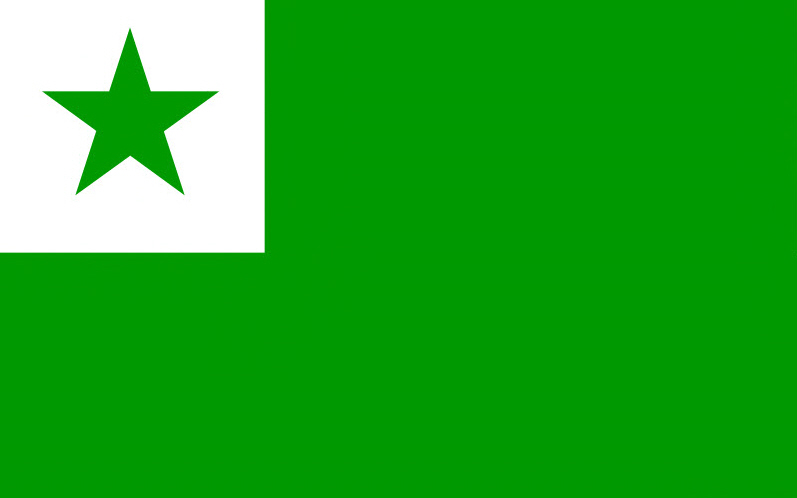





 | 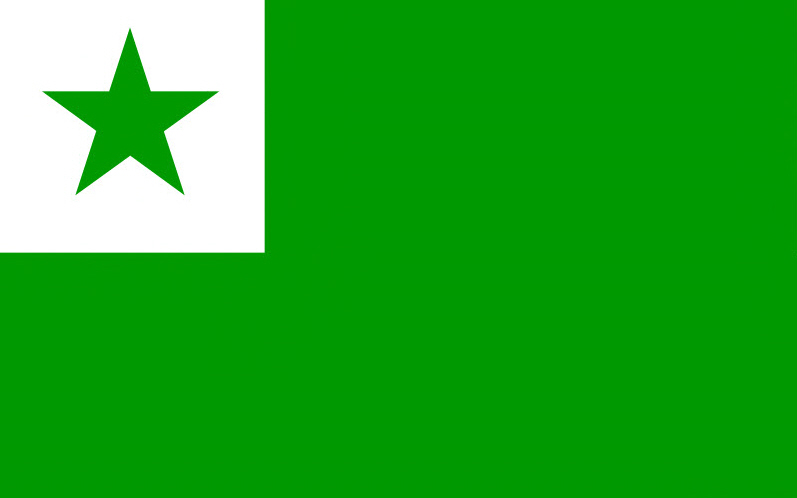





|
Soixante ans après le Concile Vatican II, il est essentiel d’examiner de manière critique les structures internes de l’Église catholique, non seulement d’un point de vue ecclésiologique ou théologique, mais aussi à partir d’une question fondamentale trop souvent passée sous silence : pourquoi le pouvoir et l’autorité dans l’Église restent-ils concentrés entre les mains d’une élite cléricale, sans participation effective du peuple chrétien, qui est pourtant, en théorie, son sujet constitutif?
Malgré les changements significatifs proposés par le Concile, la structure hiérarchique de l’Église demeure pratiquement inchangée. Pour comprendre les raisons de cette résistance au changement, il faut approfondir la distinction entre «structure» et «organisation». La structure renvoie aux éléments essentiels qui assurent la cohésion et la continuité de l’Église à travers l’histoire. Dans le discours ecclésial dominant, cette structure est identifiée à la hiérarchie, c’est-à-dire au corps épiscopal compris comme successeur du collège apostolique. Cette hiérarchie, selon ses défenseurs, garantit l’autorité doctrinale, pastorale et institutionnelle. Mais cette «continuité» est-elle véritablement synonyme de fidélité à l’Évangile, ou bien de préservation de privilèges?
L’« organisation », quant à elle, concerne la manière dont cette structure est mise en œuvre dans des contextes historiques variés. L’Église a démontré une grande souplesse organisationnelle au fil des siècles, mais a conservé intact son noyau hiérarchique. Ce qui n’a jamais été remis en question par ceux qui détiennent le pouvoir ecclésial, c’est précisément cette structure qui permet un contrôle sans rendre de comptes au peuple croyant. Peut-on réellement parler d’une communauté guidée par l’Esprit lorsque les décisions sont prises d’en haut, sans la participation de ceux qui sont à la fois récepteurs et porteurs de la foi?
Au cours du premier millénaire, les évêques étaient choisis par leurs communautés et exerçaient leur ministère dans les Églises locales, selon une dynamique plus communautaire. Mais à partir du XIe siècle, le pouvoir du pape a commencé à se centraliser, transformant profondément l’organisation de l’Église. Bien que la même structure hiérarchique formelle ait été conservée, l’axe du pouvoir s’est déplacé vers une verticalité extrême, avec Rome comme centre hégémonique. Pourquoi a-t-on accepté sans réserve que cette centralisation reflète la volonté divine, plutôt que des stratégies humaines de pouvoir?
La question centrale ne porte pas seulement sur le fonctionnement de cette organisation, mais sur la manière dont la structure de l’Église est conçue. Lorsqu’elle sert les intérêts du centre — le pape et la curie romaine — cela révèle que ce centre a le pouvoir non seulement de définir l’organisation, mais aussi de la légitimer à travers des récits théologiques. Cela soulève une question gênante: la structure ecclésiale a-t-elle un fondement sacramentel ou juridique?
Selon les documents du Concile Vatican II, l’épiscopat a un fondement sacramentel. Pourtant, dans la pratique, nombre de fonctions de l’évêque semblent régies davantage par des critères juridiques que spirituels. Que signifie pour l’Église de proclamer une théologie sacramentelle de l’épiscopat si l’exercice du ministère dépend de l’approbation papale? Le peuple chrétien — censé participer à la communion sacramentelle — est systématiquement exclu de ce débat. Ainsi, le sacrement devient une justification symbolique d’une structure de pouvoir qui ne permet ni alternatives ni voix dissidentes.
Dans les premières communautés chrétiennes, il existait des responsables qui pourraient être vus comme une forme naissante d’épiscopat. Cependant, dans les écrits du Nouveau Testament, il n’y a pas de distinction claire entre évêques et presbytres. Ce n’est qu’à la fin du IIe siècle que les évêques ont commencé à être reconnus comme successeurs des apôtres. Pendant plusieurs siècles, ce rôle épiscopal a coexisté avec une théologie encore indéfinie. En réalité, même aujourd’hui, la théologie de l’épiscopat reste un champ ambigu, sans développement systématique permettant de justifier le modèle actuel de suprématie papale et de soumission épiscopale.
À partir du XIIe siècle, la réflexion théologique sur le sacrement de l’Ordre s’est développée, mais centrée sur le sacerdoce, et non sur l’épiscopat. Cela a conduit à une vision de l’évêque comme prêtre ayant juridiction sur les autres — subordonné à un système juridique plutôt qu’inscrit dans une communion sacramentelle. Un modèle pyramidal s’est ainsi consolidé: le pape comme évêque suprême doté d’une autorité juridique sur l’ensemble de l’épiscopat, du clergé et, bien sûr, des fidèles. Cette interprétation a été soutenue théologiquement par des figures comme Thomas d’Aquin et Albert le Grand, mais ses racines idéologiques se trouvent dans les réformes du pape Grégoire VII et de ses collaborateurs, qui ont utilisé de faux documents attribués à l’Édit de Milan pour légitimer la suprématie papale.
La structure centralisée actuelle de l’Église repose en partie sur ces fondations manipulées. Bien que ces sources aient été démasquées comme des faux, elles ont continué à être utilisées pour affirmer que «tout pouvoir dans l’Église vient du pape». Comment l’autorité spirituelle peut-elle s’appuyer sur un fondement historiquement frauduleux et politiquement motivé? Et pourquoi le peuple chrétien est-il privé du droit de questionner ces contradictions?
Le Concile Vatican II n’a pas résolu cette ambiguïté — il l’a seulement mise en lumière. Dans Lumen Gentium 21.3, il est affirmé que l’épiscopat confère la plénitude du sacrement de l’Ordre, mais il est ajouté qu’il ne peut s’exercer qu’en communion avec le pape. L’article 22.3 insiste encore sur le fait que les actes des évêques nécessitent le consentement pontifical. Si l’épiscopat a une base sacramentelle autonome, pourquoi son exercice est-il subordonné à l’autorité papale? En pratique, la structure de l’Église ne reflète pas la communion, mais l’obéissance hiérarchique et le contrôle juridique.
Cette contradiction entre le discours sacramentel et la réalité juridique explique nombre de tensions internes dans l’Église. Bien que le Concile ait défini l’Église comme un sacrement de communion, la réalité est qu’elle fonctionne comme une structure juridique soutenue par des décrets, des normes et des codes. Cette logique verticale se reproduit dans chaque diocèse, où l’évêque agit comme un vice-roi du pape, et les laïcs sont relégués à l’obéissance, sans participation réelle.
Ce n’est pas un hasard si le chapitre III de la Constitution dogmatique Lumen Gentium parle de l’Église non comme du Peuple de Dieu, mais comme d’une «société hiérarchiquement constituée». Pourquoi cette dualité ? Ces sections ont-elles été rédigées par des factions opposées au sein du Concile? La réalité est que beaucoup de documents conciliaires sont le fruit de tensions et de compromis entre des positions contradictoires au sein de l’épiscopat, ce qui explique qu’ils contiennent des affirmations contradictoires. Ils ne doivent donc pas être idéalisés comme une synthèse harmonieuse, mais plutôt lus comme un instantané d’un conflit de pouvoir non résolu au sein de l’Église.
Les questions fondamentales restent sans réponse : qui détient le pouvoir suprême dans l’Église? D’où provient-il? Quel est le véritable rôle de l’épiscopat? Pourquoi le peuple chrétien est-il systématiquement exclu de ces débats ? L’histoire des conciles montre que, loin de clarifier ces questions, ils les ont souvent complexifiées.
Les conciles de Constance et de Bâle, par exemple, ont affirmé qu’un concile général avait autorité sur le pape. Cette position a cependant été renversée par le concile de Florence, qui a de nouveau proclamé la suprématie pontificale. Depuis lors, les conciles suivants — Latran V, Trente, Vatican I — n’ont pas cherché à répondre aux défis du monde moderne, mais à protéger un modèle de pouvoir déjà en déclin. Paradoxalement, cette posture défensive était une réaction contre une société chrétienne que l’Église elle-même avait contribué à façonner, mais qui évoluait désormais hors de son contrôle.
Le Concile Vatican II a tenté un tournant, en cherchant le dialogue avec la modernité. Mais son esprit de renouveau ne s’est pas reflété dans la structure institutionnelle. L’autorité papale et curiale est restée intacte, tandis que le peuple chrétien continuait d’être exclu. À une époque où le monde réclame participation, transparence et horizontalité, l’Église reste ancrée dans un modèle hiérarchique rigide, vertical et excluant.
Ce décalage entre le discours et la pratique, entre les proclamations sacramentelles et les pratiques autoritaires, est insoutenable. Une révision profonde du modèle ecclésial est aujourd’hui urgente. non pour le détruire, mais pour le rendre cohérent avec l’Évangile qu’il proclame et avec la communauté qu’il prétend servir.