
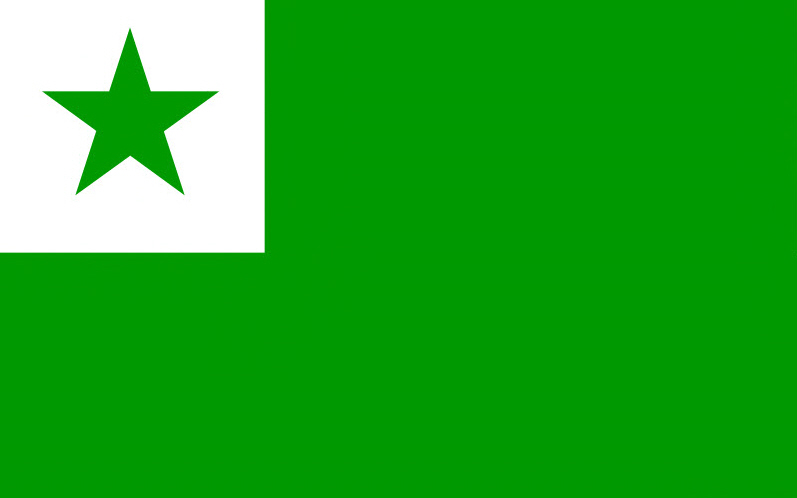








 | 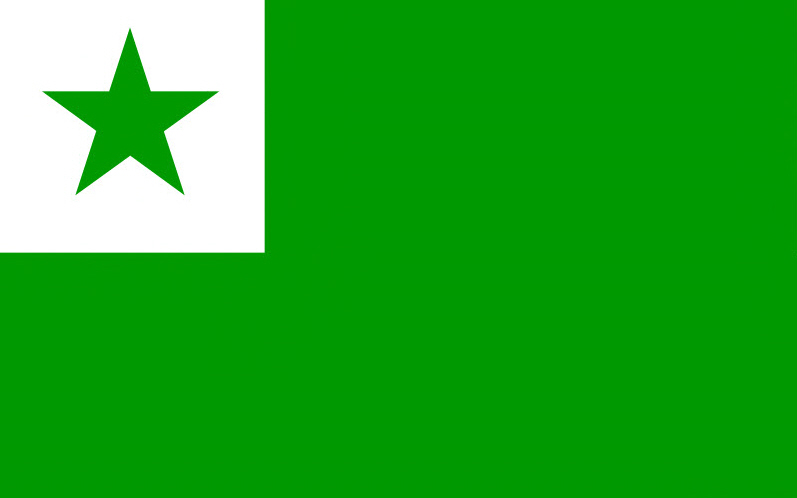








|
Aujourd’hui, un chrétien qui choisit de vivre l’Évangile de manière sérieuse peut apparaître comme une figure dérangeante, voire suspecte. Son engagement envers les enseignements de Jésus — non-violence, justice, attention aux pauvres, rejet du pouvoir et du consumérisme — provoque souvent de l’inconfort, même au sein de l’Église elle-même. Une telle personne est perçue comme étrange, comme un idéaliste hors de propos ou, pire, comme une menace.
Cette réaction n’est pas le fruit du hasard. Elle trouve ses racines profondes dans l’histoire du christianisme, qui a commencé comme un mouvement persécuté et a fini comme une institution puissante. En chemin, le message révolutionnaire de Jésus a perdu de sa force. Ce Jésus pauvre, ami des marginalisés et critique du pouvoir religieux, a été remplacé par une figure plus confortable, plus décorative.
Aujourd’hui, ceux qui veulent vivre l’Évangile avec intégrité — en choisissant les pauvres, en rejetant le luxe, en recherchant la justice — rencontrent de la résistance, non seulement dans le monde, mais aussi au sein de l’Église. Vivre comme Jésus et demander à l’Église de Lui ressembler est une menace pour ceux qui préfèrent une foi confortable, adaptée au système. Le christianisme authentique n’est ni docile ni conformiste : il est critique, prophétique, et inconfortable. L’Évangile n’est pas une théorie pour les livres ; c’est une invitation à transformer la vie. À ses débuts, la foi chrétienne est née parmi des gens ordinaires qui partageaient ce qu’ils avaient, priaient ensemble et vivaient dans l’espérance. Il n’y avait ni temples, ni hiérarchies. Ce qui comptait, ce n’étaient pas les dogmes, mais l’amour, la justice et la communauté.
Mais avec le temps, la foi est devenue de plus en plus intellectuelle. Ce qui était autrefois un mode de vie s’est transformé en discours abstraits et en une série de dogmes byzantins. Des débats faisaient rage sur la nature de Dieu, tandis que la souffrance humaine réelle était oubliée. L’Évangile, qui devait conduire à l’engagement, s’est éloigné de la vie et s’est retrouvé prisonnier de doctrines qui ne changeaient rien. La théologie a cessé d’être une voix proche du peuple et est devenue un exercice qui ne remet plus rien en question.
Revenir à l’Évangile, c’est revenir à l’essentiel : écouter les pauvres, partager la vie, pardonner, et rêver d’un monde nouveau. L’Incarnation n’est pas seulement une croyance : c’est Dieu qui entre dans l’humanité et sa fragilité. En Jésus, Dieu se révèle dans le petit et le quotidien. Il ne domine pas — Il accompagne. Et cela bouleverse toutes les structures de pouvoir.
On peut mieux comprendre cette contradiction en considérant les forces qui ont façonné l’histoire de l’Église : le pouvoir et la richesse. À partir de l’Édit de Milan au IVe siècle, l’Église cesse d’être une communauté persécutée de base pour devenir une structure privilégiée avec une influence politique et économique dans l’Empire romain. Dès lors, la volonté de contrôler, d’accumuler des richesses, d’établir des hiérarchies et d’imposer des normes depuis une position de supériorité commence à éloigner l’institution du mode de vie que Jésus prêchait et vivait. La dimension révolutionnaire du christianisme a été absorbée par une institution qui, à partir du IVe siècle, s’est imbriquée avec le pouvoir politique et économique. Le changement décisif survient vers l’an 370, lorsque les riches et les puissants entrent massivement dans l’Église. Cela introduit une logique étrangère à l’Évangile. Les élites, formées à la rhétorique impériale et à l’administration, prennent des rôles ecclésiastiques et réorganisent la communauté avec des structures hiérarchiques. Ainsi, le christianisme passe d’une foi marginale à une institution socialement influente centrée sur l’orthodoxie.
Ce qui était une bonne nouvelle pour les pauvres a été adapté aux intérêts des puissants. Cette logique persiste aujourd’hui. Le problème n’est pas seulement historique : les structures actuelles de l’Église reflètent souvent encore ce modèle.
La communauté chrétienne, qui devrait être un espace de service, est devenue une autorité sur la vie des personnes. Avec cette transformation sont venues des décisions qui n’avaient que peu à voir avec l’Évangile : la justification de l’esclavage, l’exclusion des femmes, l’imposition de normes rigides sur la sexualité. Une doctrine a été construite pour exclure, et non pour accueillir.
La richesse et le pouvoir sont devenus les critères pour exercer l’autorité. La fidélité au message de Jésus — qui appelle au service et à une vie simple — a été remplacée par une obéissance institutionnelle centrée sur le contrôle. Ceux qui ont tenté de vivre l’Évangile depuis les marges ont été réduits au silence, car leur vie révélait la contradiction entre ce que l’Église prêchait et ce qu’elle pratiquait réellement.
Revenir à l’Évangile, c’est un appel à un changement radical. Il ne s’agit pas seulement de réformes ou de moderniser le langage, mais d’une conversion profonde : écouter à nouveau la voix de Jésus, qui appelle depuis le bas, depuis les exclus. Cela signifie rompre avec les structures qui ne reflètent plus la mission de construire le Royaume de Dieu sur la Terre, et retrouver une foi vivante et engagée.
Dans ce contexte, le clergé a pris des décisions qui ont duré jusqu’au XXe siècle. Dès le VIIIe siècle, par exemple, les prières de la messe — le Canon — ont commencé à être dites à voix basse et exclusivement en latin, une langue que le peuple ne comprenait plus. C’est aussi durant cette période que les prêtres ont commencé à célébrer la messe dos à l’assemblée. La pratique des messes privées s’est répandue : des célébrations où un prêtre officiait seul, sans la présence des fidèles ni même d’enfants de chœur, souvent dans de petites chapelles. Ainsi, la liturgie, qui était à l’origine une expérience communautaire, est devenue un acte réservé presque exclusivement au clergé, tandis que les laïcs étaient réduits à un rôle passif et obéissant.
En parallèle, ces transformations liturgiques ont donné naissance à un système économique qui favorisait le clergé. Aux premiers siècles du christianisme, les fidèles apportaient des offrandes à l’autel, qui étaient ensuite redistribuées selon les besoins de la communauté. Mais avec la consolidation institutionnelle du clergé, ces offrandes ont été remplacées par des paiements monétaires que les laïcs devaient effectuer pour les messes. Cette logique tarifaire s’est étendue à d’autres sacrements et rites religieux comme les baptêmes, mariages, confirmations, funérailles et fêtes patronales.
Il en est résulté des pratiques marquées par une grave opacité morale. Un exemple clair est celui des fameuses « messes grégoriennes » : une série de 30 messes célébrées pendant 30 jours consécutifs, avec la promesse d’accélérer la libération de l’âme du purgatoire. Le coût de ces messes était nettement plus élevé que celui d’une messe ordinaire. Pour compenser le faible prix de ces dernières, certains prêtres ont commencé à célébrer plusieurs messes à la chaîne. À cela s’ajoutait le commerce encore plus lucratif et controversé des indulgences, promu par le pape Léon X pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome.
Les hiérarchies ecclésiastiques ont cessé d’être au service du peuple et ont été occupées par ceux qui incarnaient les valeurs du pouvoir : prestige, politique, influence. Au lieu de suivre le Bon Pasteur, beaucoup de responsables se sont comportés comme des administrateurs soucieux de préserver leur autorité, reléguant l’Évangile au second plan. Un exemple ancien est la doctrine du pape Gélase Ier en 494, qui séparait le domaine spirituel du domaine temporel, marquant le début d’une tension durable où l’Église cherchait aussi à dominer le temporel. Se réclamant de l’autorité divine, l’Église a voulu exercer un pouvoir au-delà du religieux, influençant la politique, l’économie et la vie quotidienne. La papauté est devenue une figure à la fois doctrinale et civile, rivalisant avec les empires. Cette fusion du spirituel et du temporel a créé une ambiguïté dangereuse : l’Église, appelée à incarner le Royaume de Dieu, a commencé à agir comme un royaume de plus, en quête de contrôle. Elle s’est éloignée de Celui qui a refusé d’utiliser le pouvoir pour se sauver Lui-même et a dénoncé les structures religieuses oppressives. La foi a cessé d’être vécue comme une expérience transformatrice et est devenue un système de règles. Le salut était promis uniquement aux obéissants. L’Évangile était lu, mais non vécu. Ce qui aurait dû être une force de libération est devenu une religion au service de l’ordre établi. La relation avec Jésus a été remplacée par la soumission à la hiérarchie.
Au Moyen Âge, ce pouvoir a atteint son apogée. Le pape n’était plus un parmi d’autres, mais le chef suprême, doté d’un pouvoir total. Il dictait les lois, jugeait, gouvernait. L’Évangile a été relégué par une Église devenue une cour. L’autorité n’était plus comprise comme un service, mais comme un contrôle. Un moment clé dans la centralisation du pouvoir ecclésiastique fut le Dictatus Papae de 1075, dans lequel Grégoire VII affirmait la suprématie du pape sur toute autorité humaine, même les empereurs. Ce n’était pas seulement une réforme institutionnelle, mais une affirmation théologique qui brouillait la frontière entre spirituel et temporel. Cette vision atteignit son extrême avec la bulle Unam Sanctam de 1302, qui exigeait la soumission au pape comme condition du salut. Ce n’était pas symbolique — c’était un enseignement officiel qui faisait du pouvoir ecclésiastique le médiateur nécessaire entre Dieu et l’humanité.
Le 8 janvier 1454, le pape Nicolas V prit une décision qui semble aujourd’hui incompréhensiblement injuste, bien qu’à l’époque elle s’inscrivît dans la théologie du pouvoir développée depuis Grégoire VII. Confiant dans sa « plénitude du pouvoir apostolique », le pape accorda au roi du Portugal rien de moins que tous les royaumes d’Afrique. Ce « don » incluait le droit de saisir tous les domaines, possessions et biens, et d’envahir, conquérir et réduire en esclavage les peuples africains à perpétuité. Cette concession « généreuse » et extravagante fut confirmée par d’autres papes, dont Léon X en 1516 et Paul III en 1634. Ainsi, le « don » de l’Afrique au Portugal, fondé sur la théologie de la plenitudo potestatis et soutenu par trois papes, est un fait historique indéniable qui révèle le rôle et l’influence de la papauté dans le développement du colonialisme.
La « générosité » pontificale ne s’arrêta pas au Portugal ; elle s’étendit à l’Espagne. Il est bien connu que le pape Alexandre VI accorda aux monarques espagnols les îles et terres découvertes ou à découvrir. Il traça même une ligne imaginaire à 100 lieues à l’est et au sud des Açores et du Cap-Vert pour diviser les territoires des couronnes espagnole et portugaise. Dans sa bulle Inter Caetera du 4 mai 1493, Alexandre VI reconnaissait la présence d’or, d’épices et de nombreuses autres richesses dans les nouvelles terres. Le pape, s’estimant autorisé « librement, en toute connaissance de cause et en vertu de la plénitude du pouvoir apostolique », accordait aux Rois Catholiques « plein, libre et absolu pouvoir, autorité et juridiction » sur ces territoires.
Le christianisme, au lieu de libérer, a été utilisé pour dominer. Pour de nombreux peuples, la croix a cessé d’être un symbole d’espérance pour devenir un symbole de soumission. Des cultures entières furent détruites avec l’appui d’une théologie au service du pouvoir. Cette histoire ne s’est pas arrêtée. Encore aujourd’hui, il existe des discours religieux qui justifient l’exclusion et l’inégalité. L’Église n’a pas seulement été témoin : elle a été protagoniste d’un système qui a utilisé la foi pour opprimer. Ce qu’il y a de plus grave, c’est que beaucoup l’ont fait en toute connaissance de cause, avec des rituels, des bénédictions et des documents pontificaux. La théologie, au lieu d’être prophétique, est devenue un sédatif qui justifie le pouvoir. Elle a réconforté les riches au lieu de les appeler à la conversion. Ainsi, elle a trahi l’Évangile, qui ne bénit pas les empires. Pour que l’Église retrouve sa crédibilité, elle doit affronter cette histoire avec courage. Elle doit examiner les racines qui ont permis une telle cécité.
Aujourd’hui, le système de domination — le capitalisme fondé sur la propriété privée et le marché — ne reçoit aucune condamnation ni remise en question de la part de la hiérarchie ecclésiastique qui détient encore le pouvoir dans l’Église. Pendant la messe, le message de l’Évangile qui remet en question ce système est réduit à une brève lecture liturgique, suivie généralement d’une interprétation superficielle et sans engagement, qui ne propose aucune transformation du monde selon la vision de Jésus. Les liens avec la richesse et le pouvoir continuent de modeler l’action de l’Église, qui oriente souvent les fidèles vers des pratiques dévotionnelles et des actes de culte centrés sur le salut éternel, sans promouvoir de changements concrets dans les structures terrestres d’injustice.
L’Évangile authentique demeure vivant, non dans le pouvoir, mais dans les marges, parmi ceux qui suivent Jésus avec amour et sans chercher de privilèges. Il n’est pas venu pour soutenir les structures, mais pour enflammer une vie nouvelle fondée sur la liberté et l’amour. Aujourd’hui, il est urgent de revenir à Jésus — non pas celui institutionnalisé, mais Celui qui marche avec les pauvres et affronte l’injustice. La question n’est pas de savoir ce que veut l’Église, mais ce dont le monde a besoin : justice, pain, tendresse, vérité. Ce n’est qu’en incarnant ces mots que le christianisme pourra retrouver son âme. Celui qui suit ce chemin n’est pas seul : il marche avec les blessés, les rêveurs, et avec Dieu Lui-même, qui ne s’impose pas d’en haut, mais se donne depuis le bas. Cet Évangile ne se prêche pas — il se vit. Et ce n’est qu’ainsi que le christianisme pourra être sauvé de lui-même.
